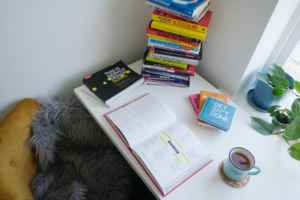(Dossier basé sur l’ouvrage anthologique Le must de la stratégie, préfacé par Gabriel Joseph-Dezaize)
Outre le magazine bimestriel, l’univers Harvard Business Review France comprend des carnets qui proposent aux cadres et aux dirigeants des conseils de management rapides et simples à mettre en œuvre, des livres de référence et des numéros spéciaux, les musts, qui déclinent une thématique en plusieurs articles rédigés par les meilleurs experts en management, RH ou stratégie. Ce premier volet de la série des Cahiers est ainsi consacré à un sujet crucial pour toutes les entreprises en quête de sens dans un monde turbulent : la stratégie. Les articles sélectionnés pour ce « must » sont huit incontournables pour guider votre réflexion et préciser vos choix stratégiques, toujours aisément applicables à l’entreprise- cabinet, rédigés par les meilleurs spécialistes de la question, depuis la question fondamentale et finalement pas si simple « Qu’est-ce que la stratégie ? » jusqu’à sa mise en œuvre.
V. Réussir l’exécution de votre stratégie (Gary L. Neison & Karla L. Martin)
Gary L. Neilson est vice-président du bureau de Chicago du cabinet de conseil en management Booz & Company (devenu Strategy &) et coauteur de « The Passive-Aggressive Organization » (HBR, octobre 2005). Karla L. Martin est son associée du bureau de San Francisco.
Une stratégie brillante, un produit phare ou une technologie révolutionnaire peuvent vous rendre compétitif, mais seule une exécution efficace vous permettra de le rester. Vous devez être capable d’atteindre vos objectifs. Malheureusement, la grande majorité des entreprises admettent leur faiblesse en la matière. Pendant cinq ans, Neison et Martin ont invité des milliers de salariés (dont environ 25 % de cadres supérieurs) à évaluer, à l’aide d’un questionnaire en ligne, les capacités de leur entreprise. Ils ont ainsi généré une base de données de 125 000 profils correspondant à plus de mille entreprises, administrations et organismes à but non lucratif dans plus de cinquante pays. Dans trois organisations sur cinq, les employés ont jugé que l’exécution au sein de leur entreprise était médiocre. C’est-à-dire qu’une majorité d’entre eux a déclaré ne pas être d’accord avec l’affirmation suivante : « Les importantes décisions stratégiques et opérationnelles sont rapidement traduites en actions. »
L’exécution est le résultat de milliers de décisions prises chaque jour par des employés qui agissent en fonction des informations dont ils disposent et de leur propre intérêt. Dans le cadre de l’assistance que le cabinet de Neison et Martin apporte à plus de 250 entreprises pour leur apprendre à améliorer l’exécution de leur stratégie, ils ont identifié quatre piliers fondamentaux que peuvent mobiliser les cadres dirigeants pour influencer ces actions : clarifier les droits de décision, concevoir des flux d’information, définir des « motivateurs » et revoir la structure.
Dans leurs efforts visant à améliorer leurs performances, la plupart des organisations prennent en premier lieu des mesures structurelles : d’une part, parce que déplacer les lignes d’un organigramme semble être la solution la plus évidente et, d’autre part, parce que ces changements sont visibles et concrets. En général, cette étape porte rapidement ses fruits à court terme, mais elle ne s’attaque qu’aux symptômes du dysfonctionnement, pas à ses causes profondes. Après plusieurs années, c’est donc le retour à la case départ. Le changement structurel peut et doit faire partie du chemin menant à une meilleure exécution, mais il est préférable de le considérer comme la touche finale et non comme la clé de voûte de toute transformation organisationnelle. En fait, cette étude montre que les actions liées aux droits de décision et à l’information sont bien plus importantes (environ deux fois plus efficaces) que les améliorations apportées aux deux autres piliers fondamentaux.
Prenons le cas d’un fabricant mondial de biens de consommation ayant choisi la voie de la réorganisation au début des années 1990 (dans cet exemple comme pour les suivants, les informations qui permettraient d’identifier les organisations ont été modifiées). Déçue par les performances de la société, la direction a fait comme la plupart des entreprises à l’époque: elle s’est restructurée, a supprimé des niveaux hiérarchiques et élargi le champ des responsabilités. Les dépenses de personnel concernant les managers ont rapidement baissé de 18 %. Mais huit ans plus tard, c’était déjà du passé : le mille-feuilles hiérarchique avait réapparu et le champ des responsabilités s’était de nouveau rétréci. En ne s’intéressant qu’à la structure, la direction s’était attaquée aux symptômes visibles de ses mauvaises performances mais pas à leurs causes, à savoir la manière dont les décisions étaient prises et dont les personnes en étaient tenues responsables.
Cette fois-ci, la direction est donc passée outre les lignes de l’organigramme et les étiquettes pour mieux se pencher sur la manière dont le travail était effectué. Au lieu de chercher comment réduire les coûts, elle s’est concentrée sur l’amélioration de l’exécution et a découvert par la même occasion les véritables causes de sa faible performance. Les managers ne savaient pas clairement quels étaient leurs responsabilités et leurs rôles respectifs. Ils ne savaient pas de manière intuitive quelles étaient les décisions qu’il leur incombait de prendre. En outre, le lien entre performance et récompense était ténu. Cette entreprise possédait de bonnes compétences en micro-management et était à l’aise avec l’idée de se remettre en cause. Mais, en matière de responsabilité, c’était une tout autre histoire. Les managers intermédiaires consacraient 40 % de leur temps à se justifier et à rendre des comptes à leurs supérieurs, ou bien à questionner leurs collaborateurs directs sur les décisions stratégiques.
Cette prise de conscience a permis à l’entreprise d’élaborer un nouveau modèle de management définissant qui était responsable de quoi et établissant la connexion entre performance et récompense. Par exemple, la norme dans cette société (courante dans le secteur) était de promouvoir les salariés rapidement – entre un an et demi et deux ans – avant même qu’ils n’aient la chance de voir aboutir leurs projets. Résultat, les managers, à tous les échelons, poursuivaient leurs anciennes tâches après avoir été promus : ils gardaient un œil sur leurs collaborateurs directs désormais en charge de leurs projets et prenaient trop souvent le relais. Aujourd’hui, les salariés occupent leur fonction plus longtemps, de manière à pouvoir suivre leurs projets jusqu’au bout, et ils sont toujours présents lorsque les fruits de leur travail commencent à être récoltés. Sans compter que les résultats de ces projets continuent de peser dans leurs évaluations de performance après leur promotion – pendant une période donnée -, ce qui oblige les managers à être à la hauteur des objectifs qu’ils avaient fixés à leur poste précédent. Ainsi, les prévisions sont devenues plus précises et plus fiables. Ces mesures ont aussi donné naissance à une structure dotée d’un nombre d’échelons réduit et de champs de responsabilité plus étendus, mais ce n’était qu’un effet secondaire et non la clé de voûte de ces changements.
Les facteurs d’une exécution efficace
Ces conclusions résultent de décennies d’applications pratiques et de recherches approfondies. Au début des années 2000, les auteurs ont décidé de réunir des données empiriques pour identifier les actions les plus efficaces quant à la mise en œuvre de la stratégie d’une organisation. Quels étaient les principaux moyens de restructurer, de motiver, d’améliorer les flux d’informations et de clarifier les droits de décision ? Ils ont commencé par dresser une liste de dix-sept caractéristiques (telles que la libre circulation des informations dans l’entreprise, ou le degré auquel le top management s’abstient de se mêler des décisions opérationnelles), chacune correspondant à un ou plusieurs des piliers fondamentaux capables, selon eux, d’assurer une exécution efficace. Avec ces éléments en tête, ils ont mis au point un générateur de profils en ligne permettant aux employés d’évaluer les capacités d’exécution de leur entreprise. Durant les quatre années qui ont suivi, ils ont collecté les données de plusieurs milliers de profils. Cela a permis de mieux évaluer l’impact de chaque caractéristique sur la capacité d’une entreprise à exécuter et de les classer par ordre d’influence relative, pour arriver à cette synthèse :

Classer ces caractéristiques leur a permis de comprendre l’importance des piliers « droits de décision » et « information » dans l’exécution efficace de la stratégie, puisqu’ils correspondent aux huit premières caractéristiques. Seules trois caractéristiques sur dix-sept sont liées au pilier « structure » et les trois se situent en bas du tableau, après le treizième rang.
Créer un programme de transformation
Les quatre piliers fondamentaux auxquels les managers peuvent faire appel pour améliorer l’exécution de la stratégie (droits de décision, information, structure et « motivateurs ») sont intrinsèquement liés. Si les droits de décision ne sont pas clairs, non seulement cela paralyse le processus décisionnel, mais cela freine aussi la transmission des informations, dissocie la performance des récompenses et suscite des solutions de contournement qui bouleversent les rapports hiérarchiques officiels. Le blocage de l’information se traduit par des décisions médiocres, des évolutions de carrière limitées et un renforcement de la structure en silos. Que faire pour y remédier ?
Dans la mesure où chaque entreprise est unique et est confrontée à un ensemble de variables internes et externes qui lui sont propres, il n’y a pas de réponse universelle à cette question. La première étape consiste à identifier les sources du problème. Dans leurs travaux, Neison et Martin commencent souvent par demander aux employés de l’entreprise de remplir un questionnaire de profilage et par consolider les données. Plus il y a de répondants, mieux c’est.
Une fois que les dirigeants ont compris les points faibles de leur entreprise, ils peuvent prendre un certain nombre de mesures. Toutes ces mesures tendent à renforcer une ou plusieurs caractéristiques parmi les dix-sept. Par exemple, si vous deviez prendre des mesures pour « clarifier et rationaliser la prise de décision à chaque niveau opérationnel », vous pourriez renforcer deux éléments : « Chacun sait de quelles décisions et actions il/elle est responsable » et « Une fois prises, les décisions sont rarement remises en cause ». La plupart des entreprises ne disposent pas de la capacité managériale ou de la volonté organisationnelle de prendre plus de cinq ou six mesures à la fois. Et, comme nous l’avons souligné, les mesures prioritaires sont celles relatives aux droits de décision et à l’information, puis réfléchir aux changements à apporter aux « motivateurs » et à la structure pour étayer votre nouveau modèle.
Pour aider les entreprises à comprendre leurs lacunes et à élaborer le programme d’amélioration le plus efficace possible, Neison et Martin ont mis au point un simulateur de changement organisationnel. Cet outil interactif complète l’action du générateur de profils en permettant de tester virtuellement différents éléments d’un programme de changement, de voir lesquels ciblent le mieux le point faible spécifique de votre société. Le site www.simulator-orgeffectiveness.com (uniquement en anglais) vous permet d’élaborer et de tester divers programmes de changement organisationnel en cinq étapes et d’évaluer lequel serait le plus efficace et productif pour améliorer l’exécution dans votre cabinet.
Pour se faire une idée du processus du début à la fin (du diagnostic au lancement de votre transformation organisationnelle en passant par la formulation de la stratégie), les auteurs étudient le parcours d’une compagnie d’assurances que nous appellerons Goodward Insurance. Goodward était une entreprise prospère possédant d’importantes réserves de capitaux et enregistrant une croissance continue de son chiffre d’affaires et de sa clientèle. Malgré tout, sa direction souhaitait encore améliorer l’exécution afin de réaliser un ambitieux programme stratégique sur cinq ans incluant des objectifs très audacieux en matière d’augmentation du nombre de clients et du chiffre d’affaires, et de réduction des coûts ; ce qui nécessitait une nouvelle façon de travailler en équipe. Malgré quelques coopérations transversales, les unités avaient davantage l’habitude de se concentrer sur leurs propres objectifs, ce qui ne permettait pas d’économiser des ressources et de les mettre au service des objectifs des autres unités. Dans de nombreux cas, les unités étaient de toute façon peu incitées à le faire : si les objectifs de l’unité A supposaient la contribution de l’unité B pour être réalisés, ceux de l’unité B n’incluaient pas de soutenir l’unité A.
La société avait lancé plusieurs projets à l’échelle de toute l’entreprise par le passé, qui ont certes abouti dans le respect des délais et des budgets, mais qui ont souvent dû être retravaillés car les besoins des parties prenantes n’avaient pas été suffisamment pris en compte. Après avoir lancé un centre de services partagés, par exemple, la société a dû revoir son modèle opérationnel et ses procédures quand les unités se sont mises à recruter du personnel en renfort pour s’occuper de tâches prioritaires que le centre ne pouvait assumer. Le centre pouvait alors décider quelles applications technologiques développer lui-même plutôt que de fixer des priorités en fonction de ce qui importait le plus à l’entreprise. De même, les lancements de produits phares étaient entravés par une coordination insuffisante entre les départements. Le département marketing mettait au point de nouvelles options d’assurance sans demander à l’équipe chargée des sinistres si elle était capable de les traiter. Étant donné qu’elle ne l’était pas, le personnel chargé des procédures a dû créer d’onéreuses solutions de contournement manuelles lorsque ces nouveaux types de sinistres commencèrent à lui parvenir. L’équipe marketing n’avait pas non plus demandé à l’actuariat comment ces produits affecteraient le profil de risque et les dépenses de remboursement de la compagnie. Alors, pour certains produits, les coûts ont augmenté.
Pour identifier les principaux obstacles au développement d’une culture de l’exécution plus forte, Goodward Insurance a transmis le questionnaire de diagnostic à l’ensemble de ses 7 000 employés et comparé les scores relatifs aux dix-sept caractéristiques avec ceux des entreprises efficaces en matière d’exécution. Nombre d’enquêtes précédentes (sur la satisfaction des employés, notamment), avaient exclu les commentaires qualitatifs concernant les obstacles à l’excellence en matière d’exécution. Mais ce diagnostic a fourni à la société des données quantifiables qu’elle pouvait analyser par groupe et par niveau hiérarchique pour déterminer quels étaient les obstacles qui gênaient le plus les salariés chargés de l’exécution. Il s’avéra que les managers intermédiaires étaient bien plus pessimistes que les dirigeants dans leur évaluation de la capacité d’exécution. Leur contribution est devenue essentielle dans le programme de changement adopté.
Le questionnaire a permis à Goodward Insurance de découvrir que ces obstacles à l’exécution s’apparentaient à trois des aspects organisationnels les plus importants :
• L’information ne franchissait pas facilement les frontières organisationnelles. L’échange d’informations n’a jamais été le point fort de Goodward, mais les managers ont toujours considéré que la mauvaise transmission des informations entre les unités était « le problème d’un autre département ». Le diagnostic organisationnel a toutefois montré que cette excuse était insuffisante. Lorsque le P-DG a examiné les résultats du générateur de profils avec ses collaborateurs directs, il a présenté le graphique des flux d’information et déclaré : « Cela fait des années que nous discutons de ce problème et, pourtant, vous dites toujours qu’il s’agit du problème d’untel ou d’unetelle et pas du vôtre. Pour 67 % des répondants, l’information ne circule pas facilement entre les divisions. Ce n’est pas le problème d’untel ou d’unetelle : c’est notre problème. On n’obtient des résultats aussi bas que si les problèmes viennent de tous les côtés. Nous devons tous nous atteler à cela. »
L’absence de promotions transversales contribuait également à ce manque de fluidité horizontale de l’information. Car Goodward avait toujours promu ses employés de manière verticale plutôt que transversale, et la plupart des managers intermédiaires et supérieurs restaient au sein d’une même division. Ils n’étaient pas tenus correctement informés des activités des autres départements et ne disposaient pas d’un réseau de contacts englobant toute l’entreprise.
• Les informations importantes concernant le contexte concurrentiel n’étaient pas transmises rapidement au siège. Le diagnostic, les enquêtes et entretiens réalisés ultérieurement avec les responsables intermédiaires ont révélé que des informations erronées remontaient aux oreilles de la hiérarchie. Les décisions quotidiennes ordinaires étaient transmises à l’exécutif (la direction devait par exemple approuver les décisions de recrutement prises par les niveaux intermédiaires, ou encore le versement de la moindre prime de 1 000 dollars), ce qui limitait l’agilité de Goodward, c’est-à-dire sa capacité à réagir aux actions des concurrents, aux besoins des clients et aux évolutions du marché en général. En attendant, les informations plus importantes avaient tellement été filtrées au fur et à mesure de leur ascension jusqu’à la direction qu’elles en devenaient inutiles pour prendre des décisions clés. Quand bien même les managers au bas de l’échelle savaient qu’un certain projet ne fonctionnerait jamais pour des raisons valables, ils ne le disaient pas au top management. Non seulement les initiatives vouées à l’échec étaient lancées, mais elles étaient poursuivies. Par exemple, l’assureur souhaitait créer de nouvelles incitations pour ses courtiers : même si cette approche avait déjà été expérimentée par le passé – sans succès – personne n’en a soufflé mot durant les réunions ou n’a mis fin au projet, car il s’agissait d’une priorité pour l’un des dirigeants de Goodward.
• Personne ne savait de quelles décisions et actions il/elle était responsable. La mauvaise circulation générale de l’information s’était étendue aux droits de décision, car peu de managers savaient où s’arrêtait leur autorité et où commençait celle des autres. La responsabilité des décisions, même les plus banales, n’était pas claire et les managers ne savaient pas à qui demander des précisions. Naturellement, cette confusion favorisait la remise en cause des décisions : 55 % des répondants estimaient que les décisions étaient régulièrement remises en cause.
À la décharge de l’assureur, ses dirigeants ont immédiatement réagi aux résultats du diagnostic en lançant un programme de changement ciblant ces trois domaines problématiques. Ce programme prévoyait des premiers changements souvent symboliques avec des initiatives à plus long terme, afin d’impulser une dynamique et de galvaniser la participation et l’appropriation. Reconnaissant qu’une attitude « passive-agressive » à l’encontre des personnes que l’on pensait être investies de pouvoirs en raison seulement de leur position dans la hiérarchie freinait la transmission de l’information, la direction a pris des mesures immédiates pour montrer son intention de créer une culture plus informelle et plus ouverte. Changement symbolique : le plan de table lors des réunions de la direction a été revu. Les hauts dirigeants avaient l’habitude de s’asseoir à l’écart et cette séparation physique était lourde de sens. À présent, ils se mélangent aux autres, se rendent plus accessibles et encouragent davantage les collaborateurs à échanger de manière informelle. Des réunions casse-croûte ont été mises en place avec les membres du comité de direction, durant lesquelles les participants peuvent discuter d’une initiative globale de changement de culture, des droits de décision, de nouveaux mécanismes de communication entre les unités, etc. L’attribution des sièges y est minutieusement préparée afin de garantir la représentation des différentes unités à chaque table. Des activités visant à briser la glace ont été conçues pour encourager les employés à découvrir le travail des autres unités.
Dans le même temps, les managers ont cherché à remédier aux problèmes liés à la circulation de l’information et aux droits de décision. Ils ont évalué leurs propres réseaux informels afin de comprendre comment les personnes prenant les décisions clés obtenaient leurs informations, et ont ainsi identifié d’importantes lacunes. Un nouveau cadre a été élaboré pour prendre ces décisions importantes, spécifiant clairement qui est responsable de quelle décision, qui doit fournir les informations, qui assume la responsabilité finale des résultats et comment ces résultats sont définis. D’autres initiatives à long terme ont été définies :
- La délégation de certaines décisions aux niveaux inférieurs de la hiérarchie afin de mieux faire correspondre les droits de décision aux informations disponibles. La plupart des décisions relatives aux recrutements et aux primes, par exemple, ont été déléguées aux responsables immédiats dès lors qu’ils respectent des limites préétablies concernant les effectifs recrutés et les niveaux de salaires. Définir clairement qui a besoin de quelle information encourage le dialogue entre les unités.
- L’identification des commissions doublons et leur suppression.
- La transmission des indicateurs et tableaux de bord jusqu’en bas de l’échelle hiérarchique, de sorte qu’au lieu de chercher à savoir qui a provoqué un problème, la direction peut aller directement à la cause première, au « pourquoi ». Un tableau de bord bien conçu présente non seulement les résultats (tels que les volumes de ventes ou le chiffre d’affaires) mais également des indicateurs permettant d’expliquer ces résultats (par exemple, le nombre d’appels de clients ou de contacts clients aboutis). Résultat, les conversations de la direction ont changé de priorité : celle-ci ne cherche plus à expliquer le passé mais plutôt à planifier l’avenir, à anticiper et à éviter les problèmes.
- L’ouverture du processus de planification. Les groupes définissent explicitement la manière dont leurs initiatives dépendent les unes des autres et s’influencent mutuellement. Des objectifs communs sont assignés en conséquence.
- L’amélioration des trajectoires de carrière des managers intermédiaires pour mettre l’accent sur l’importance de la mobilité transversale en matière d’évolution professionnelle.
Goodward Insurance vient juste de s’engager dans cette voie. L’assureur a réparti la responsabilité de ses initiatives entre divers groupes et niveaux hiérarchiques afin que les efforts ne soient pas eux-mêmes compartimentés. D’ores et déjà, d’importantes améliorations en matière d’exécution commencent à émerger. Les premiers signes de succès proviennent des enquêtes de satisfaction des salariés : les réponses des managers intermédiaires concernant la collaboration entre les unités et la clarté de la prise de décision ont gagné entre vingt et vingt- cinq points de pourcentage. Les collaborateurs les plus performants franchissent déjà les frontières pour mieux comprendre l’entreprise dans son ensemble, même si cela ne se traduit pas, dans l’immédiat, par une promotion.
L’idée de départ en pratique
Concentrez-vous d’ores et déjà sur les deux leviers essentiels à une exécution de stratégie réussie :
– Droits de décision :
• Assurez-vous que chaque collaborateur de votre cabinet sait de quelles décisions et de quelles actions il est responsable.
Exemple :
Chez un fabricant mondial de biens de consommation, les décisions prises par les directeurs de division ou de secteur géographique étaient outrepassées par les directeurs de fonction qui contrôlaient l’affectation des ressources. Les prises de décision étaient retardées. Les divisions mobilisaient du personnel pour élaborer de solides argumentaires remettant en cause ces décisions, et les frais généraux ne cessaient d’augmenter. Afin de favoriser une nouvelle stratégie visant à replacer le client au centre de l’activité, le P-DG a clairement confié aux divisions la responsabilité des profits.
• Encouragez les supérieurs à déléguer les décisions opérationnelles (ce qui vaut aussi pour vous).
Exemple :
Dans une organisation caritative internationale, les directeurs nationaux ne savaient pas déléguer, ce qui paralysait le processus de décision. La direction les a encouragés à se délester des tâches opérationnelles ordinaires, ce qui leur a permis de se concentrer sur l’élaboration de stratégies nécessaires pour réaliser la mission de l’organisation.
– Flux d’informations :
• Veillez à ce que les informations importantes relatives au contexte concurrentiel vous soient rapidement transmises afin de pouvoir identifier des modèles et instaurer des bonnes pratiques dans tout le cabinet.
Exemple :
Dans une compagnie d’assurances, des informations pourtant exactes sur la viabilité des projets étaient censurées durant leur transmission vers la direction. Pour améliorer la remontée des informations, l’entreprise a pris des mesures pour créer une culture plus informelle et plus ouverte. Les cadres dirigeants ont commencé à se mélanger aux responsables d’unités durant les réunions de management et à organiser des réunions casse- croûte pour discuter des problèmes les plus urgents.
• Favorisez la circulation des informations au-delà des frontières organisationnelles.
Exemple :
Afin de mieux gérer ses relations avec ses importants clients multiproduits, une société de B2B devait instaurer le dialogue entre les unités. Elle a ainsi chargé sa nouvelle équipe marketing centrée sur la clientèle d’encourager la communication au sein de l’entreprise. Le groupe a produit des comptes rendus réguliers analysant les performances par rapport aux objectifs (par produit et par secteur géographique), ainsi que des analyses causales expliquant les écarts de performance. Des réunions trimestrielles de management de la performance ont suscité la confiance nécessaire à cette coopération.
• Aidez vos collaborateurs à comprendre comment leurs choix quotidiens affectent les résultats de votre cabinet.
Exemple :
Chez un prestataire de services financiers, les commerciaux élaboraient souvent des offres uniques et personnalisées pour leurs clients, qui coûtaient davantage que ce qu’elles rapportaient à la société. Les commerciaux n’étaient pas conscients du coût et de la complexité de ces opérations. La direction a résolu ce problème de manque d’information en adoptant une approche commerciale de « personnalisation intelligente ». Pour les contrats sur mesure, elle a instauré des procédures de back-office standardisées (telles que l’évaluation du risque). Elle a également mis au point des outils d’aide analytique afin de mieux informer les commerciaux des répercussions financières de leurs offres de transactions. La rentabilité s’en est trouvée améliorée.
Les auteurs concluent sur la notion que l’exécution est un défi éternel et bien connu. Même dans les entreprises qui s’en sortent le mieux (les « organisations résilientes »), seuls deux tiers des salariés estiment que les grandes décisions stratégiques et opérationnelles sont rapidement traduites en actions. Tant que les entreprises continueront de s’attaquer à leurs problèmes d’exécution armées principalement ou seulement d’initiatives structurelles ou motivationnelles, elles échoueront toujours. Nous l’avons vu, elles peuvent obtenir des résultats à court terme, mais elles reprendront inévitablement leurs anciennes habitudes car elles ne se seront pas occupé des causes profondes du problème. De tels échecs peuvent presque toujours être surmontés : il suffit de s’assurer que les employés comprennent de quoi ils sont responsables et qui prend les décisions, puis de leur donner les informations dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités. Une fois ces deux piliers en place, les éléments structurels et motivationnels suivront.