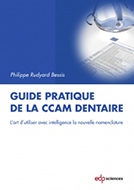Introduction à la CCAM
La CCAM (Classification commune des actes médicaux), anciennement la NGAP (Nomenclature générale des actes médicaux) a l’avantage de lister tous les actes réalisables par les chirurgiens-dentistes. La NGAP ayant été reconnue obsolète, incomplète, impossible à décrypter, incohérente au niveau tarifaire et motif de procédures contre les praticiens du fait des libres interprétations qu’elle générait, elle a donné naissance à la CCAM. La CCAM concerne tous les actes médicaux (elle est exhaustive, 7200 actes y figurent) effectués par tous les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant où et à quelque titre que ce soit. La CCAM identifie chaque acte par un code spécifique (elle est bijective) et permet une connaissance qualitative et quantitative de la consommation de soins.
A un acte correspond un code : c’est le principe de l’acte global. Pour un même soin, sauf exceptions, on compte 4 actes maximum au cours d’une même intervention.
A un code correspond un libellé et un prix unitaire. Le système de tarification sera basé sur l’exploitation des codes et ne fera plus référence aux lettres-clés et aux coefficients actuels. Le prix unitaire d’un acte correspondra à l’honoraire versé au professionnel de santé et résultera de la négociation tarifaire. L’objectif de la refonte des honoraires est d’élaborer une nomenclature neutre : l’honoraire est établi en fonction des ressources (physiques et intellectuelles) mobilisées par le praticien. La valeur du travail (l’honoraire) égale le travail médical et le coût de la pratique. Le système est cependant très complexe. Des modulations de la tarification sont possibles.
La détermination du travail médical se fait en 2 étapes.
La première est celle de la hiérarchisation des actes au sein de chaque spécialité étudiée. Le travail médical (W) a 4 composantes : la durée, le stress, la compétence technique et l’effort mental. L’acte de référence est un acte fréquent, bien standardisé, demandant un travail modéré, servant d’unité de mesure pour tous les actes de la spécialité et dont le score est fixé à 100 par convention.
La deuxième étape est la recherche de passerelles entre les spécialités afin d’obtenir une hiérarchisation inter-spécialité. On recherche des « actes-liens », puis on établit une échelle unique de scores exprimés en « points de travail ».
Le prix du travail égale le score multiplié par le facteur de conversion. Le travail médical égale le score du travail médical (W) multiplié par le facteur de conversion monétaire. Pour estimer le facteur de conversion monétaire (valeur en F d’un point de travail), il faut disposer du montant total de l’enveloppe relative aux actes de la CCAM, du montant total du coût de la pratique, de la somme de points travail (le score multiplié par la fréquence, le tout multiplié par la « somme de »).
L’honoraire égale le tarif de l’acte multiplié par le facteur de conversion monétaire ajouté au coût de la pratique unique pour chaque acte. La valeur de l’acte est alors égale à la somme du prix du travail et du coût de la pratique par acte.
Mais tout le problème de l’évaluation des tarifs est qu’elle dépend des disponibilités financières des organismes sociaux, alors c’est la réalité financière du cabinet qui devrait primer.
Le coût de la pratique (CP) comprend les charges professionnelles du praticien (loyer, personnel, matériel…), mais pas les dépenses à la charge des établissements.
Les charges comprennent les charges totales (calculées grâce à la Direction générale des impôts) et les surcoûts. Les charges générales sont les charges totales auxquelles on soustrait les surcoûts. Le coût de la pratique égale des charges générales ajoutées aux surcoûts.
Les charges générales sont affectées au prorata des points de travail. Pour les obtenir, on divise le total des charges habituelles de la profession par la totalité du travail.
Pour les chirurgiens-dentistes, la charge habituelle de la profession égale les charges totales auxquelles on soustrait les frais de prothèses. La totalité du travail est constituée de la totalité des points de travail réalisés par la profession.
Pour les actes sans surcoût, la CP égale le W multiplié par les charges générales par point travail (Cg). Pour les actes avec surcoût, la CP égale le W multiplié par la Cg, les surcoûts éventuels en F par acte (S) étant ajoutés au tout.
Pour estimer l’honoraire pour chaque acte, on prend donc en compte le score de traval (W), le facteur de conversion monétaire unique (FC), les charges générales par point traval (Cg) et les surcoûts éventuels en F par acte (S).
Honoraire = W (FC + Cg) + S
Mais les problèmes sont nombreux. Tous les actes sont-ils susceptibles d’être honorés de façon neutre ? Quid du problème de la tarification du facteur de conversion monétaire et sa dépendance de l’enveloppe globale des actes techniques dont dispose la CCAM ? Le coefficient « charge générale » est-il vraiment le même pour tous les praticiens ? Peut-on vraiment pour les actes prothétiques neutraliser la tarification dépendant de la notion de « tact et de mesure » pour la remplacer par un simple surcoût du prix du technicien de laboratoire ?
Pour chaque acte codé et donc facturé, on note la lettre clé, le coefficient, les majorations, l’identifiant du professionnel, la date d’exécution, la quantité, le montant des honoraires, le code motif de dépassement, les frais de déplacement et le numéro de la dent concernée. Pour bien définir et classer chaque acte dentaire, 16 codes de regroupement existent (exemple, le code 1, noté ADC, concerne les « actes de chirurgie »). Un acte global est caractérisé par 9 codes : le code principal (7 caractères), le code activité (1), le code extension documentaire (1), la phase de traitement (1), les modificateurs tarifants (1 ou 2), les modificateurs non tarifants (1 ou 2), le code association non prévue (1), le code remboursement exceptionnel (1) et le top supplément de charges en cabinet (1).
Le système de codification consiste en un code semi-structuré de 7 caractères calé sur la structuration des libellés. AA pour topographie (site anatomique ou fonction physiologique ; pour la dentisterie, le plus souvent c’est H, « tractus digestif et orgnes de la digestion » ; la deuxième lettre correspondant à l’organe ou à la fonction, pour la dentisterie HB, « dents, parofonte, gencives ») puis A pour action (selon qu’on agrandit, comprime, déplace, draine, extrait etc., la lettre sera différente) et A pour accès A par exemple signifie « abord ouvert ») et/ou technique et NNN pour le compteur aléatoire.
Au niveau du code A (action), on note A s’il s’agit d’une action sur les dimensions (par exemple un allongement coronaire, coté HBAA), E s’il s’agit de ramener un organe déplacé dans sa position anatomique normale (une réimplantation par exemple se cote HBED), F s’il s’agit d’une action sur la position (par exemple, une pulpectomie se cote HBFD), G s’il s’agit d’une action sur la position avec traction (une extraction par exemple se cote HBGD), J concerne d’autres actions sur la position, les assainissements, détrartages (HBJD), irrigations, lavages, nettoyages… Q concerne les actions d’observation (une radiographie se cote HBQK), K concerne d’autres actions sur la position (le changement d’une facette d’une prothèse dentaire amovible, par exemple, se note HBKD). L concerne aussi des actions sur la position, ou des implantations. L’application d’un topique pour hypersensibilité dentinaire se cote HBLD009, la pose d’un implant intraosseux intrabuccal chez l’adulte se cote LBLD015. M concerne les actions de réparation (une obturation de cavité se cote HBMD).
Le code activité identifie, pour un même acte, le nombre d’intervenants nécessaires. En dentaire, c’est toujours 1.
Pour le code association, il existe 5 possibilités, selon que l’acte est tarifé à 100, à 50 ou à 75%. Il y a réduction de la tarification si plusieurs actes sont effectués au cours d’une même séance.
Le code modificateur prévoit le cas d’enfants de moins de 5 ou 13 ans et les urgences (jours férés, nuits…).
D’autres codes existent (extension documentaire, phase de traitement, remboursements exceptionnels et suppléments de charges), mais les 4 codes les plus importants sont le code de l’acte, le code activité, le code phase de traitement et le code association (4 ou 1 pour 100% de la tarification, 2 pour 50% de la tarification).
Pour chaque code d’acte dentaire, la CCAM précise si une localisation dentaire est attendue. Si oui, le praticien indiquera soit le code à 2 chiffres de chaque dent traitée correspondant à l’acte réalisé, soit le code à 2 chiffres du ou des sextant(s) concerné(s) par l’acte réalisé ou maxillaire. Par exemple, 01 correspond au maxillaire, 02 au mandibule, 03 au sextant supérieur droit…
La consultation
Elle est définie par plusieurs textes législatifs. Même si elle se fait en 2 séances, la cotation reste unique.
Son tarif est opposable et ne peut faire l’objet de dépassement d’honoraires, comme tous les tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes et portant sur des actes inscrits à la nomenclature. Ce tarif est, en France métropolitaine, actuellement de 23€. Les assurés ou ayant droits ont aussi parfois droit, sous conditions, à des examens bucco-dentaires de prévention comprenant obligatoirement une anamnèse, un examen bucco-dentaire et une sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire. Si des soins (conservateurs, chirurgicaux ou de radiographie) s’avèrent nécessaires, ils entrent dans le dispositif conventionnel. Dans une même séance, on ne peut facturer à la fois consultation et examen de prévention. Un bilan bucco-dentaire chez un jeune se facture 30€.
Les actes CCAM pris en charge à 100% consécutifs à l’ebd « enfant » sont à consulter.
Les radiographies dentaires
Ce sont les actes sur lesquels la vigilance doit être la plus grande : il faut les garder absolument toutes, lisibles, de qualité et montrant bien toute la dent concernée. Les contrôleurs ont le droit de vous réclamer des dizaines voire des centaines de radios du jour au lendemain.
Pour donner lieu à remboursement, tout acte de radiodiagnostic doit comporter une incidence radiographique (argentique ou numérique) matérialisée (film ou épreuve) et un compte-rendu complet, daté, écrit et signé par le médecin.
La dent ou le groupe de 1 à 3 dents contiguës (dents ayant des faces de contact mésiales et distales, avec ou sans diastème) doit être entièrement visible à la radiographie. Il ne doit pas y avoir d’erreur de numérotation, ni d’erreur de nom des patients. Qualité et lisibilité de la radiographie doivent être bonnes. La radio cotée et facturée est exigible à la première demande du patient ou du contrôleur. Bien sûr, toute radio doit être médicalement justifiée.
Les clichés inexploitables ne sont pas cotés. Tout cliché est la propriété de l’assuré.
La facturation se fait quel que soit le nombre de clichés réalisés sur un même secteur de 1 à 3 dents contigües. Par exemple, la radio de la 15 concerne donc la 16, la 15 et la 14.
Certaines radios, dont la liste est à consulter, ne peuvent être facturées pour un traitement endodontique. Les agénésies dentaires multiples liées à des maladies rares ou des séquelles de tumeurs de la cavité buccale ou des maxillaires ne sont pas facturables lors d’un bilan implantaire ou de la pose d’un implant intrabuccal en dehors d’une réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Les radios ne se cotent pas individuellement mais globalement. Pour 1 radio, 1 cotation. Pour 2 (ou 10) radios, 1 seule cotation aussi.
Les tableaux indiquant les cotations comprennent 5 colonnes : la définition de l’acte (1), la cotation CCAM (2), la cotation NGAP (3), la base de remboursement NGAP (4) et la base de remboursement CCAM tarif opposable (5).
Attention, on ne peut pas coter plus de 14 radios rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires en une séance pour un bilan radiographique, même si on a effectué beaucoup plus de radios.
Prophylaxie, hygiène dentaire et prévention
Les cotations CCAM varient selon qu’il s’agit de sealents, de détartrage, de blanchiment, éclaircissement ou cosmétologie dentaire ou de prophylaxie, d’hypersensibilité et de reminéralisation.
Le détartrage est l’acte le plus courant ; il comprend le polissage, mais pas le traitement des colorations des dents. Il doit être achevé en deux séances maximum et la cotation des séances nécessaires est limitée (les cotations sont renouvelables 6 mois après la dernière séance). Que l’on y passe une heure ou cinq minutes, la cotation reste la même. Si le tartre s’est reformé en moins de six mois, c’est au patient de le prendre en charge.
La séance de motivation, enseignement de l’hygiène et de mise en pratique des différentes méthodes de brossage adaptées au patient, est un acte NPC (non pris en charge) dont la cotation, au jour de cette publication, n’existe plus. Les détartrages sont compatibles avec d’autres soins : les cotations peuvent se cumuler.
Au niveau des éclaircissements (NPC), la cotation varie selon que les dents sont vivantes ou mortes.
Le blanchiment peut se faire via la face externe ou via la face interne de la dent. Les cotations varient selon ces cas.
Au niveau de la prophylaxie (dont, comme pour le détartrage, les actes sont pris en charge sous conditions), de l’hypersensibilité et de la reminéralisation, un devis doit être établi. L’acte ne peut commencer qu’après accord éclairé du patient.
Les obturations de cavités, les inlays-onlays
Chaque obturation réalisée sur une même dent est cotée de façon autonome en fonction du nombre de faces concernées et indépendamment des autres cavités traitées. L’obturation doit être médicalement justifiée, correctement réalisée et pérenne. Par contre, quel que soit le nombre de cavités traitées, il n’y a pas de limitation de cotation. Les dépassements d’honoraires ne sont pas admis, sauf pour les inlays et onlays (cotés en fonction du nombre de faces intéressées). Les cavités se cotent en fonction du nombre de parois. Modifier la cotation d’une paroi en cavité à 2 ou 3 parois est une fraude « facile », mais bien connue des contrôleurs. Toutes les cavités réalisées sur une même dent se cotent séparément et individuellement (sur le document, une cotation par ligne).
Un sealent et une cavité sur une même face ne peuvent être cotés que s’ils sont réalisés distinctement.
La restauration d’une dent inclut l’anesthésie, l’exérèse des tissus lésés, de la lésion carieuse de la dent, la préparation amélodentinaire et la protection dentinopulpaire. L’obturation peut se faire avec ou sans recouvrement cuspidien. Le décompte des faces ou des angles s’entend pour une lésion.
Au niveau des obturations de cavité avec tenon radiculaire, noter que si les tenons des reconstitutions avec ancrage radiculaire ne sont pas obligatoirement en métal et visibles à la radio, leur longueur doit être conforme aux connaissances scientifiques. Le tenon doit servir à une rétention radiculaire certaine de l’obturation coronaire.
Le praticien se doit, même si le patient change d’avis sur les soins qu’il accepte, d’éviter le « bricolage thérapeutique » et de ne pas coter des actes qui ne sont effectués que le temps que le patient se décide à accepter le traitement qu’il lui faut.
La dévitalisation, les traitements de première intention et autres soins des canaux
Le traitement canalaire est l’acte le plus difficile et le plus ingrat de la profession.
Pour le traitement des canaux, 3 à 4 radios doivent être prises. La digue est obligatoire et il ne doit pas y avoir plus de 3 semaines entre la séance d’endodontie et l’obturation définitive et la prothèse. L’acte est opposable ou ne l’est pas : attention aux dépassements d’honoraires indus. Une pulpectomie est un acte global qui peut avoir de multiples cotations : pulpotomie d’abord, puis pulpectomie (l’une ou l’autre, mais pas les deux). A une pulpectomie d’une racine de molaire correspond une cotation totale. Sauf cas particulier (faute du patient), on ne cote pas une seconde fois un travail que l’on a soi-même déjà effectué.
Comme toujours, il faut consulter les exemples donnés par la CNAM.
La reprise de traitement canalaire
La pulpectomie (dont les définitions précises sont à consulter) consiste globalement à éliminer chirurgicalement le tissu pulpaire vivant de la dent. La reprise de traitement des racines obturées par autrui n’entre pas dans cette définition, ni dans celle des soins de gangrène pulpaire.
Il existe donc deux traitement différents : le traitement endodontique initial et le retraitement endodontique. Indications, explications et consentement éclairé du patient sont prévus. Le coût n’étant pas pris en charge par les organismes sociaux, il faut définir les honoraires avec tact et mesure et bien en informer le patient. La reprise de traitement canalaire est un acte hors nomenclature.
La CCAM distingue deux cas : lorsqu’il y a un instrument fracturé et (plus courant) lorsqu’il y a reprise du traitement canalaire suite à une obturation de la dent avec des produits d’obturation et aucun autre corps étranger.
Les facturations concernent la désobturation puis l’obturation canalaire après nettoyage radiculaire. Il y a une cotation par geste effectué. Le consentement éclairé du patient, après devis, est indispensable.
Au niveau des désobturations endodontiques, elles n’incluent pas la mise en forme canalaire ni la réobturation radiculaire.
Les extractions dentaires
Une extraction dentaire comprend l’avulsion de dent et/ou de racine dentaire avec ou sans curetage alvéolaire, avec ou sans régularisation osseuse de l’arcade alvéolaire.
Pour être cotée, une extraction doit être complète. Tout l’organe dentaire doit être enlevé. L’avulsion d’une dent peut entrainer de graves problèmes et des litiges. Toujours bien informer le patient, et tout consigner sur le dossier médical.
La parodontologie
Par secteur dentaire, on entend portion de l’arcade dentaire correspondant à l’implantation habituelle des dents considérées, que cette portion doit dentée ou non.
La gingivoplastie est, selon Lindhe, le « remodelage chirurgical de la gencive afin d’obtenir des contours physiologiques ». On ne peut qualifier de gingivectomie les incisions gingivales initiatrices de lambeaux dans le cadre des chirurgies parodontales. L’acte global reste la chirurgie parodontale avec l’exérèse du tissu de granulation et le curetage des parties infiltrées : il est coté HBJA003. Il n’est pas pris en charge et doit être accepté en connaissance de cause par le patient.
Les gingivectomies ne sont pas non plus les incisions gingivales initiatrices de lambeaux dans le cadre des chirurgies implantaires. L’acte global reste l’implantologie. Les gestes thérapeutiques effectués lors d’un soin hors nomenclature sont eux aussi hors nomenclature.
La gingivectomie, indiquée en cas d’hyperplasie gingivale ou d’augmentation anormale du volume tissulaire gingival, consiste en la section de la partie gingivale pathologique. C’est un acte chirurgical complet, non l’initiation d’un autre acte.
La seule gingivectomie remboursable est celle qui concerne un secteur de 4 à 6 dents. Toutes les autres sont NPC. Attention : lorsqu’on effectue 2 gingivectomies d’un secteur de 4 à 6 dents, la 2ème cotation doit être cotée à 50% de sa valeur avec le code association 2.
Si on associe d’autres actes (actes de chirurgie anciennement cotés en KCC) à des actes bucco-dentaires figurant au g, la tarification est particulière. Attention, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association.
Implantologie
Sauf exceptions (maladies rares), la pose d’implants osseux dans le crâne et la face est un acte NPC. Le cas échéant, la prise en charge se fait sous conditions.
Lorsque la cotation existe mais que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, la cotation reste valable mais l’acte devient non remboursable. Il faut alors conserver la cotation mais rajouter « NPC ». Dès qu’il y a devis et obtention du consentement éclairé du patient, les honoraires sont libres.
La prothèse sur implant
Les prothèses plurales (bridges) implantoportées ne sont pas prises en charge. Dans un bridge seuls les piliers sont cotés, pas l’intermédiaire de bridge.
La cotation de la contention et du mainteneur d’espace interdentaire sont à étudier.
Le devis et l’information au patient
L’affichage des prix dans la salle d’attente est obligatoire (décret n°2009 -152 du 10 février 2009), sous peine de sanctions. Selon que vous êtes conventionné, conventionné avec droit permanent au dépassement ou non conventionné, il faut aussi réaliser des affiches spécifiques.
Le devis est obligatoire (Code de la sécurité sociale, Code de la santé publique, DGCCRF, Convention nationale des chirurgiens-dentistes) pour tous les actes NPC ou pour ceux qui impliquent un dépassement d’honoraires. Il doit être soigneusement rédigé. Les honoraires facturés sont distingués en trois composantes : le prix de vente du dispositif médical sur mesure proposé, le montant des prestations de soins et les charges de structure du cabinet. Le calcul de ces composantes se fait à partir des données individuelles de la déclaration 2035 du chirurgien-dentiste de l’année N-2.
Les charges globales du cabinet incluent les charges personnelles, les charges d’achat et les autres charges (dites charges de structure).
Le taux de charges de structure correspond à la part de l’honoraire total représentée par l’ensemble des charges du cabinet hors achats et hors charges personnelles. Une formule spécifique permet de le calculer : (BR-BA-JY-BV-BS-CH) / AG.
Le prix de vente du dispositif s’obtient en divisant le prix d’achat au fournisseur par (1 – le taux de charges de structure).
Le montant des prestations de soins de l’acte égale honoraire de l’acte multiplié par (1 – le taux de charges de structure) auquel se soustrait le prix d‘achat du dispositif.
Les charges de structure égalent l’honoraire de l’acte auquel se soustraient le montant des prestations de soins dont se soustrait le prix de vente du dispositif.
Les calculs se font comme pour un acte à honoraire non plafonné. La différence entre l’honoraire habituel et l’honoraire plafonné est déduite du montant des prestations de soins.
En cas d’exercice en société d’exercice libéral (SEL), il faut appliquer des correspondances. Attention, les paragraphes sur le consentement du patient aux soins et les honoraires doivent être particulièrement bien rédigés, sous peine de n’avoir aucune valeur juridique.
Les patients bénéficiaires de la CMU sont des patients comme les autres, qui peuvent faire les mêmes choix que les autres.
Les devis implantaire, parodontal ou celui concernant des actes non remboursables doivent comprendre les mentions obligatoires du devis prophétique conventionnel. Il faut détailler avec précision gestes et temps opératoires, objectifs et coûts. Des mentions particulières, soigneusement rédigées, sont à ajouter aux devis classiques. Au niveau du devis parodontal, la nécessité d’une hygiène poussée doit être soulignée. Pour les devis d’éclaircissement, bien noter la teinte initiale des dents du patient sur le devis et rappeler toutes les consignes (ne pas fumer, boire de thé, manger de fruits rouges etc.).
Il faut dissocier actes incrits à la nomenclature et actes NPC.
Eviter de ne facturer le patient qu’à la toute dernière séance : s’il part avec tout le provisoire en bouche (par exemple pour une couronne), ce qui est son droit (Code de la santé publique : « [Le consentement du patient] peut être retiré à tout moment ».), vous en serez pour vos frais. Toutes les étapes du travail, payantes, doivent être payées. Ainsi, avec un devis prophétique bien rédigé, le patient demeure libre de partir à tout moment, et le praticien est payé pour son travail.
Prothèses dentaires fixées et bridges
Sont inclues sa conception, sa réalisation, son adaptation et sa pose. L’usage des prothèses n’est pas limité ; leur renouvellement dépend de leur usure ou de l’évolution de la bouche. Couronnes sur dents temporaires, couronnes ou dents à tenons préfabriquées, provisoires ou à recouvrement partiel sont NPC. Les couronnes dentaires en équivalents minéraux incluent les couronnes dentaires céramocéramiques.
Le bridge dont un des deux piliers est non durablement reconstituable par une obturation est pris en charge sur la base de 279,50€.
Occlusion et correction de trouble occlusal, rescellement, descellement et dépose d’éléments prophétiques fixés, prothèses amovibles en résine, suppléments pour prothèses amovibles (dents contreplaquées), les autres appareils amovibles sur le crâne et la face, les réparations et adjonctions et la photographie doivent être correctement cotés. La CPAM donne de nombreux modèles et exemples. Au niveau de la photographie, qui pose le problème de la preuve du travail réalisé, ne pas hésiter à prendre plusieurs photos pour garder trace de tout ce qui n’est pas visible à la radiographie (érosion, perte de substance, usures mécaniques ou chimiques de l’émail, abrasions…).
Au niveau des patients CMU, le tableau des cotations comprend le code CCAM, le libellé, le code CMU transposé, le tarif de responsabilité en euros, le dépassement maximum autorisé en euros et le montant maximum autorisé, également en euros. Par exemple, pour la pose d’une couronne métallique cotée HBLD038, le code CM transposé est FDC1, le tarif de responsabilité est de 107,50€, le dépassement maximum autorisé est de 122,50€ et le montant maximum autorisé est de 230€.
Attention, pour certains actes, il y a des coefficients de majoration pour les Antilles, la Guyane, la Réunion et Mayotte.
Mise à jour
Je vous communique en pièce jointe un document de synthèse sur les actes 100% santé reprenant leur évolution tarifaire dans le temps, ainsi que 2 liens qui peuvent vous être utiles dans votre pratique au quotidien.
https://www.ameli.fr/hainaut/chirurgien-dentiste/aide-la-codification-des-actes-prothetiques